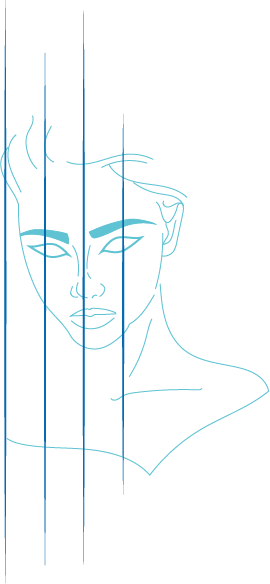Et soudain s’ouvrit le troisième œil.

Et soudain s’ouvrit le troisième œil. Endormi depuis des mois, il s’était muré dans le silence, au propre comme au figuré. Des briques étaient venues s’empiler les unes sur les autres pour combler le trou, la porte blanche qui donne sur la lumière bleue. Petit à petit, la végétation avait repris ses droits, le lierre avait grimpé entre les briques, s’était agrippé à elles jusqu’à envahir l’espace, juste assez pour qu’on oublie qu’un jour, il y avait eu un passage. Ainsi sommeilla mon troisième œil, paisible, caché.
Depuis longtemps je n’avais pas pleuré. Comme la météo, le soleil était aride, et mon fleuve était sec. Plus une goutte ne se déversait en son lit. J’étais vide.
Oh, les briques ne s’étaient pas montées toutes seules : quelqu’un les avait posées là. La porte blanche ne s’était pas barricadée d’elle-même : quelqu’un l’avait condamnée. Ce quelqu’un, c’était moi. Terrifiée par la lumière bleue de l’autre côté, et les murmures qui s’en échappaient, angoissée de ne plus être seule avec moi-même, j’ai vite tout refermé, tout arrêté. J’ai eu peur. Alors j’ai bu, et j’ai fait la fête, et j’ai fumé des cigarettes pour amoindrir cette vibration, cette aura autour de moi qui les attire. J’ai tout fait pour que ma lumière personnelle n’éclaire plus personne, pas même mon propre intérieur.
Alors, j’ai vu le monde tel qu’il est. Je suis redescendue parmi les humains et j’ai vu le monde à travers leurs yeux. J’ai vu la politique, j’ai vu la guerre, j’ai vu la peur de vieillir et la peur de mourir, j’ai vu la souffrance, j’ai vu la peine. J’ai vu la joie aussi, mais elle était superficielle, forcée, factice. Elle n’avait rien d’enviable, elle ne m’attirait pas. Le monde, tel que je l’ai vu depuis le pied du mur que j’avais construit, était laid. Il était moche, gris, sans intérêt. J’ai commencé à réaliser que la réalité ne m’intéresse pas. Les choses, les matières, les gens dont aucune des portes ne sont ouvertes sont terrifiant de vacuité. Soudain, j’étais seule. Comme un ange enfermé en dehors du paradis. Et si j’avais connu la solitude auparavant, à présent elle m’apparaissait différemment. J’étais seule, sans tourment, sans voix, sans larme, sans rien. J’étais vraiment toute seule. Mes ambitions étaient parties, mes envies aussi. Je dormais, je mangeais mal, et je buvais beaucoup, en tentant de redevenir un humain normal, avec des pensées limitantes, des ambitions cadrées et des envies insatisfaites.
C’est alors que j’ai compris les propos d’une amie : l’enfer, c’est maintenant. C’est ici. L’enfer, c’est la vie des hommes.
Je me suis ensuite posé une seule question : A choisir, préférais-je cette vie-là ? Ou préférais-je la vie dans laquelle les esprits pleurent, et chantent, et dansent ? Préférais-je voir le noir dans l’âme du monde, ou écouter son langage sifflé par le vent ? Voulais-je vraiment refermer la porte à tout ce qui me porte, tout ce qui m’élève au-dessus du monde pour le voir un peu mieux, sous prétexte que parfois, le vent est fort et froid ? La misère d’une âme en peine est plus soutenable que la misère de l’homme coincé dans la vie, parce qu’il a trop peur de mourir.
Bien sûr, mourir fait peur. Parce qu’on ne sait pas vraiment ce qu’il se passe après. On ne sait pas vraiment quel degré de conscience subsiste une fois qu’il ne reste de nous que ce petit bout d’être, cette âme, qui ne s’abrite plus dans un corps, rattaché à un cerveau qui nous permet une conscience immédiate. Bien sûr, on pense qu’après la mort, il n’y a rien que le noir et l’absence d’existence.
Et bien sûr, c’est faux. Mais il est bien plus difficile de s’en persuader que de se laisser bercer par un discours rationnel, car il est bien plus difficile de trouver la foi.
Je ne m’étais pas rendue compte que j’avais vu tout ça, et pourtant c’est bien ce qui m’a décidé à faire marche arrière. A me précipiter sur le mur, et à le frapper, frapper à coup de pelle, de pioche et de burin, arrachant les tiges, arrachant le lierre pour que dans les failles la lumière ressurgisse, jusqu’à apparaitre totalement, en inondant l’espace entre mes sourcils, mon visage, et mes yeux, ébloui par la lumière bleue.
C’est encore timide. La frontière entre les deux mondes est fine, c’est une corde sur laquelle je tangue comme un funambule. Je sais que rouvrir la porte demande un effort supplémentaire, parce qu’il faut tout recommencer. Elever sa vibration, avertir les voix que je suis là, réapprendre à les entendre, et plus encore, à les écouter. M’élever de nouveau m’oblige à plonger mes deux pieds dans la terre. Déconstruire à nouveaux les limites qui avaient ressurgies, et dépasser les peurs à cause desquelles j’avais tout arrêté.
A présent que la porte est à nouveau ouverte, je ressens dans ma poitrine cette sensation d’étrangeté, les fourmis, l’angoisse dans le ventre qui n’est pas la mienne mais qui est bien là, aussi inquiétante que rassurante : je ressens, je ne suis plus cassée. Le fleuve a cessé d’être sec, les barrages ont cédé, et l’eau coule à nouveau.