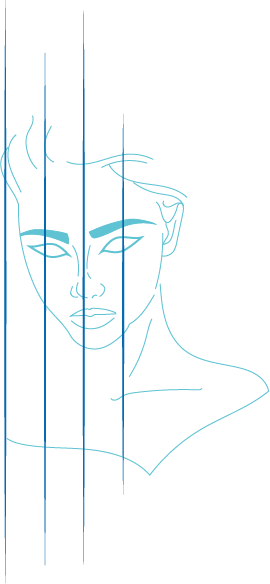Une étoile à la fois

Depuis quelque temps, j’ai le sentiment irrépressible de traverser une longue et douloureuse crise identitaire. Lorsque j’ai réalisé dans quelle quête je me trouvais, j’ai aussi très vite constaté que ce n’était pas « depuis quelques temps », mais depuis toujours.
Je me suis toujours cherchée. Qui suis-je, et que fais-je ici ? Ici sur terre, ici vivante. Toujours là mais jamais à ma place.
Il faut dire que je ne me suis jamais sentie la bienvenue où que ce soit. Non que le monde fût hostile – il l’a été parfois, mais parfois seulement. Ce manque de chaleur venait de mon propre intérieur. Je partais bille en tête que je n’étais pas voulue ici, que je n’avais rien à faire là. Que j’étais tolérée par politesse plus qu’invitée à rester. La voix à l’intérieur me rabâchait que j’étais un poids, un boulet, que je n’avais rien à faire là. Que « là » n’était pas ma place. Conséquemment, j’ai passé vraiment beaucoup de temps à me demander où diable était cet endroit pour moi. Comme si chacun des huit milliards d’individus avait une petite chaise en tissu, avec son nom dessus. Et la mienne restait obstinément vide, puisque je ne la trouvais pas.
Je parle au passé, mais je pourrais dire aussi : puisque je ne la trouve pas. Toujours pas. A l’heure où j’écris ces lignes, mon errance continue. Et pourtant, j’ai tout fait, tout essayé au nom de cette chasse infinie. J’ai testé des choses, essayé des endroits, déménagé plus souvent qu’on ne peut le compter sur les doigts. J’y ai mis toute mon énergie ; aujourd’hui je suis épuisée.
Fatiguée, lessivée, je me suis assise là dans un coin, et puisque j’étais incapable d’aller à mon identité, la vie l’a portée à moi, avec la délicatesse d’un orang-outan. Puisque je n’étais pas fichue de comprendre tous les signes qu’elle avait joliment posé sur mon chemin, elle m’a lancé un rocher au visage.
Pour me faire passer son message, la vie m’a apporté une dépression. Évidemment, j’ai d’abord pris la claque en pleine gueule, comme beaucoup avant moi. Puis, doucement, j’en suis arrivée à la conclusion qu’une dépression, sous quelques conditions, peut-être une bénédiction.
Je m’explique :
Passé les premiers mois à avoir l’impression de crever (et parfois, en venir à le souhaiter), j’ai commencé à voir plus loin. Puisque j’étais coincée dans mon cul de sac, à me demander si oui ou non j’étais arrivé au bout de la route, à la fin du jeu, je me suis assise (encore) et j’ai regardé autour de moi.
Il se trouve qu’autour de moi, c’était moi. Mes doutes, mes peurs, mes traumatismes, mes défauts, mes limites, mes valeurs, toutes mes décisions bonnes et mauvaises réunis dans le petit musée des horreurs. Aussi inconfortable que cela puisse être, c’est aussi très éclairant. C’est comme regarder une rétrospective sur sa vie, avec les commentaires du réalisateur, qui pointe du doigt mes pires défauts, mes erreurs, tout ce que j’ai si soigneusement choisi d’ignorer jusqu’à présent.
Si on a le courage de regarder le film jusqu’au bout, il est possible qu’on en sorte grandit. Pourquoi ce comportement, pourquoi cette réaction, pourquoi cette situation, pourquoi cette personne, pourquoi cette rupture ? Les vides à combler, les erreurs qu’on ne refera plus.
Lorsqu’on reprend son souffle, on réalise aussi que tous nos défauts on leur penchant positif. Rien n’est absolu. L’obscurité nous permettant de voir la lumière, nos défauts devraient nous permettre, aussi, de voir nos qualités. Et, étrangement, lorsque j’ai accepté l’idée que mes qualités découlaient de mes défauts, il a été pour moi plus simple de les légitimer.
Accepter que, dans le petit musée des horreurs, il y ait aussi une salle dédiée à la grâce. Ainsi, au milieu de cette obscurité, une à une se rallument les étoiles de ma propre constellation, celles qui me disent qui je suis, et par où je dois aller.
Entendons-nous bien : Rome ne s’est pas fait en un jour, et moi non plus. Chaque étoile se mérite, chaque pas en avant est un combat durement gagné. Régresser est une tentation à laquelle il m’est très facile de succomber, et c’est une autre lutte qui se joue en simultané. Ainsi, me voilà au combat sur plusieurs fronts. Car il est toujours plus facile de rester patauger dans un enfer confortable – dans lequel on a tout contrôle – que de prendre son baluchon pour cheminer inconfortablement vers notre propre paradis – dont on ne sait rien tant qu’on n’y est pas arrivé.
Et c’est ce second combat, qui est peut-être le plus difficile : physiologiquement, notre corps et notre cerveau sont faits pour nous protéger du danger. Aussi, quitter un univers confortable et totalement maitrisé – bien que misérable – pour la promesse (et une promesse seulement) d’un ailleurs meilleur représente une menace qui doit être très vite neutralisée. Et voilà comment des milliers (que dis-je, des millions) de gens restent là où ils sont, résignés à vivre à moitié.
Vivre à moitié, c’est pile ce qui m’a mise dans l’embarras de la dépression au départ. J’aurais pu rester où j’étais, avec une identité bancale et un métier stable, le cœur en miette et la tête en vrac. J’aurais continué de toucher un salaire confortable, de sortir aux mêmes endroits et me coucher dans le même lit rassurant. Pour éventuellement un jour mourir d’angoisse à l’idée de n’être que la moitié d’une chose, la moitié d’un être, dans la moitié d’une vie.
A la place, j’ai pris mon baluchon et, avec la moitié de courage qu’il me restait, je suis partie à l’assaut d’une montagne que je n’ose toujours pas regarder dans les yeux. Parce que, lorsque la dépression vous tient, et que chaque pas compte, mieux vaut s’en tenir à regarder ses pieds, au risque de paniquer à l’idée de tout le chemin pas encore parcouru, de tous les obstacles pas encore affrontés. Si on regarde au loin, on n’y va jamais. Parce qu’on ne sait pas comment faire, et que cette peur peut être paralysante.
Mais en regardant ses pieds, c’est à peine si on se rend compte qu’on avance. Soudain, on se remet à respirer, on prend le temps. Et on avance, même sans savoir comment : Il faut juste avoir foi dans le fait qu’on le fait.
Ainsi me voilà, jouant à « chou-fleur » avec moi-même pour ne pas rester sur la ligne de départ, un jour après l’autre, un pied devant l’autre, étoile par étoile.